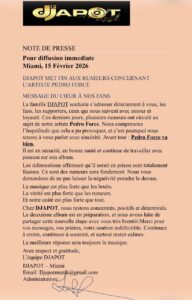Certaines de nos pratiques culturelles nous font plus de mal que de bien, surtout dans ce nouvel ordre mondial. Pendant longtemps, exprimer ses ressentis était vu comme une faiblesse, un signe de fragilité. On a appris à taire nos douleurs, à porter nos blessures en silence, surtout si l’on est noir, car, dit-on, un noir ne devrait pas montrer ses failles. Dans bien des cas, l’essentiel à avoir dans la vie se résume à un bout de pain et un toit, aussi modeste soit-il. Mais qu’en est-il de l’essentiel émotionnel ? Du droit de ressentir ?
La banalisation du suicide au sein des familles haïtiennes demeure alarmante. Trop souvent, les signes de détresse sont minimisés, étouffés sous des phrases toutes faites : « Li jis fache », « Sa ap pase », ou pire encore, « Li bezwen atansyon ». Pourtant, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon l’Organisation mondiale de la santé, le suicide représente un décès sur cent à l’échelle mondiale.
Dans un article publié le 2 septembre 2025 par ONU Info, il est rapporté que près de 727 000 personnes se donnent la mort chaque année. Et derrière chaque cas recensé, on estime qu’il y a au moins vingt tentatives. C’est dire à quel point la détresse est profonde et répandue. Le suicide figure parmi les principales causes de décès chez les jeunes, et ce, indépendamment du niveau de développement ou de richesse des pays.
Exceptionnellement, le patriarcat vient renforcer cette réalité. Il érige les hommes en figures de force et de maîtrise absolues, leur interdisant d’exprimer leur détresse. On attend d’eux qu’ils soient toujours solides, puissants, maîtres de tout, alors même que cela les enferme dans une solitude affective lourde. Paradoxalement, les femmes, bien qu’ opprimées par d’autres normes, semblent avoir un peu plus d’espace pour verbaliser leurs émotions. Ce qui nourrit une société déséquilibrée, où souffrir en silence est devenu la norme, au lieu de chercher à comprendre et soigner les blessures invisibles.
Les recherches sur les causes de tentatives de suicides
Tenter de mettre fin à ses jours n’est jamais un acte anodin. Derrière chaque tentative de suicide se cache une douleur profonde, des cris silencieux, et souvent, une incompréhension générale de la société. Depuis plusieurs décennies, chercheurs et professionnels de santé mentale s’efforcent de comprendre les racines de ce phénomène complexe, qui continue de toucher toutes les couches de la population. Au-delà des drames personnels qu’il représente, il soulève des questions profondes sur les liens entre l’individu et la société.
En 1897, le sociologue français Émile Durkheim publie «Le Suicide», une œuvre fondatrice qui aborde le suicide non pas comme un simple acte individuel, mais comme un fait social. Il le définit comme Tout cas de mort qui résulte directement ou indirectement d’un acte positif ou négatif accompli par la victime elle-même et qu’elle savait devoir produire ce résultat
Durkheim identifie alors quatre types de suicide, chacun reflétant un déséquilibre dans l’intégration ou la régulation sociales.
Le premier est le suicide égoïste. Il résulte d’une faible intégration sociale. L’individu se sent isolé, sans attaches communautaires.
Par la suite, le suicide altruiste qui est lié à une intégration excessive, où l’individu se sacrifie pour le groupe, parfois au détriment de sa propre existence.
Le suicide anomique survient lors des périodes de crise ou de changement rapide, où les normes sociales sont floues, entraînant une désorientation.
Le suicide fataliste lui, résulte d’une régulation sociale excessive, où l’individu se sent oppressé par des règles strictes et inflexibles.
Pour Durkheim, ces types de suicide illustrent comment les structures sociales influencent profondément les comportements individuels.
Des décennies plus tard, le psychologue américain Edwin S. Shneidman, fondateur de la suicidologie moderne, propose une perspective centrée sur la souffrance psychique. Il définit le suicide comme une solution à un problème perçu, une tentative de mettre fin à une douleur psychologique insupportable.
Selon Shneidman, le suicide est souvent motivé par une sentiment d’impasse. Il avance dès 1993 que le suicide est avant tout une réponse à une douleur psychologique insupportable, ce qu’il appelle le psychache. Pour lui, il ne s’agit pas d’un désir de mourir, mais d’un besoin urgent de mettre fin à une souffrance invisible. Il insiste sur l’importance de comprendre les motivations subjectives de la personne pour mieux prévenir les actes suicidaires.
Plus récemment, Klonsky et May (2015) ont élaboré une théorie en trois étapes (Three-Step Theory). La personne en détresse ressent d’abord une douleur émotionnelle intense, puis perd ses liens sociaux, et enfin, si elle en a la capacité, elle passe à l’acte.
Une étude dirigée par Michael A. Lindsey en 2019 révèle que les tentatives de suicide ont augmenté chez les adolescents noirs américains entre 1991 et 2017, illustrant les effets destructeurs de l’isolement, du racisme et de la précarité sociale.
En 2020, une autre étude, menée sur plus de 22 000 adolescents du Montana, par Zhiyuan Wei et Sayanti Mukherjee, a montré que les sentiments persistants de tristesse, le harcèlement scolaire et la consommation de substances psychoactives figuraient parmi les principaux déclencheurs.
Et qu’en est-il des solutions ?
Une recherche danoise publiée dans «The Lancet Psychiatry » (2014) a montré qu’un simple accompagnement psychologique après une tentative de suicide pouvait réduire le risque de récidive de 26 % sur cinq ans. Mais comment vraiment l’appliquer dans notre société, si auparavant, il n’y avait aucune structure de ce genre pouvant faire comprendre à nos parents et grands-parents combien il est important de prendre soin de sa santé mentale ?
En Haïti, le suicide reste un sujet tabou, souvent associé à des croyances culturelles et religieuses. Des difficultés comme le manque de données fiables et de ressources en santé mentale complique la compréhension et la prévention du phénomène. Pour ne pas simplement dire le manque de volonté qui conduirait à une mise en place efficace.
À l’heure où nous sommes davantage stigmatisés, réduits à des objets, exclus des choix cruciaux, il devient évident, d’un point de vue tant sécuritaire que professionnel, que le risque de suicide au sein de la population haïtienne est en nette augmentation. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, le suicide est un mal qui ne peut attendre. Avant même de prioriser d’autres urgences, il est essentiel de réaliser à quel point ce fléau peut faire disparaître silencieusement toute une génération. Nous serions surpris de constater à quelle vitesse notre jeunesse risque d’être effacée, si rien n’est fait.
Parler du suicide aujourd’hui en Haïti n’est plus un choix, mais une nécessité. C’est un appel à la lucidité collective, à la bienveillance et à l’action. Si nous voulons préserver notre jeunesse, notre avenir, nous devons briser les silences, dépasser les jugements, et bâtir une société où chacun peut exister, s’exprimer et guérir sans honte ni peur. Parce qu’aucune vie ne devrait s’éteindre dans l’indifférence.
Christnoude BEAUPLAN